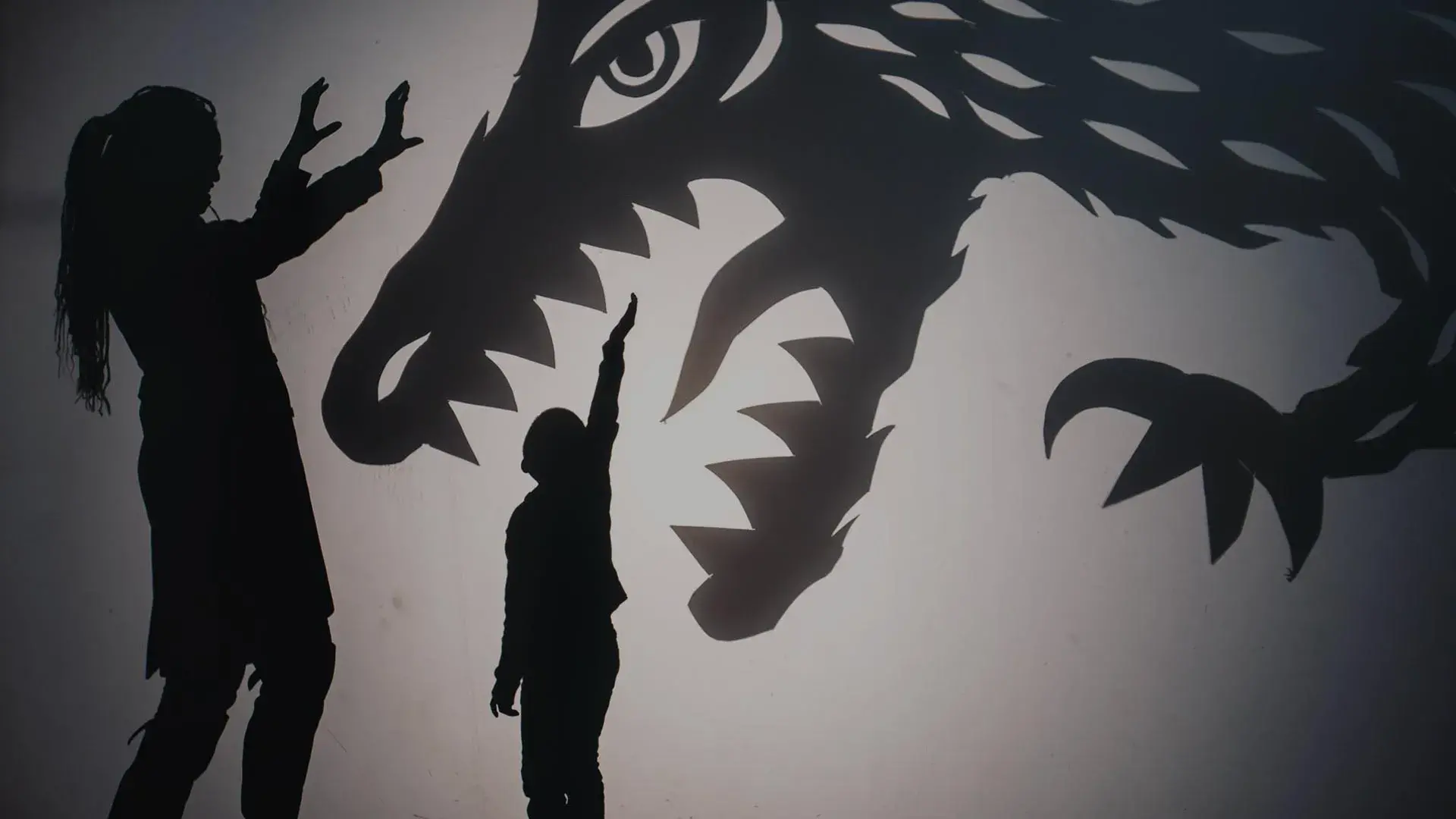Centre d'art contemporain de la Matmut - Daniel Havis
Un château à la gloire de l'art
Datant de la fin du XIXe siècle, le château dit « Le Breton » prend son nom de Gaston Le Breton, illustre érudit rouennais, qui a fait reconstruire cette demeure pour l’amour de l’art. Il a fait appel à l’architecte Lucien Lefort et le ferronnier d’art Ferdinand Marrou.
Qui est Gaston Le Breton ?

Gaston Le Breton est né le 22 novembre 1845 et est mort le 12 novembre 1920 à Rouen.
C’est un homme de lettres de la bourgeoisie rouennaise. Il occupa la direction de l’ensemble des musées de Rouen et du département. Il réorganise la plupart des musées locaux et participe à l’enrichissement de leur collection. Ce conservateur est lui-même un très grand collectionneur.
Il a découvert de nombreux objets et vestiges lors de voyages en Europe et jusqu’en Égypte. Son goût va d’abord pour la faïence. La majeure partie de ses céramiques appartient aujourd’hui au Metropolitan Museum à New-York (USA). Dans sa collection, Le Breton compte aussi des œuvres d’arts très variées comme La danse des nymphes de Corot, des œuvres de Caillebotte, Courbet, des sculptures comme le Pygmalion de Falconet aujourd’hui au Louvre, des tapisseries, des dessins… S’il fait don de quelques-unes de ses œuvres aux musées rouennais, il vend une partie de sa collection de son vivant et ses héritiers s’en séparent lors de ventes posthumes.
Un lieu dédié à l'art
De 1891 à 1898, Gaston Le Breton fait construit le château dit « Le Breton » par Lucien Lefort. Entre voyages et obligations professionnelles, Gaston Le Breton aime séjourner à Saint-Pierre-de-Varengeville, dans cette demeure d’été. Il conçoit le domaine comme un lieu culturel et y entrepose une partie de ses collections, notamment des sculptures dans le parc. C’est aussi ici qu’il reçoit des hommes politiques, des membres de la haute bourgeoisie rouennaise ainsi que ses amis du monde des arts et ses collègues de l’Institut de France. Vers 1900, de nombreux peintres, sculpteurs, musiciens et compositeurs dont Camille Saint-Saëns, séjournent au château. Gaston Le Breton meurt en 1920 et laisse le château à sa veuve qui y séjourne de temps à autre. Leur fils Raymond hérite du domaine en 1931. Il s’y installe et reçoit sa famille et ses amis pour des parties de chasse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château est réquisitionné. Pendant cette période, la famille Le Breton est logée dans une annexe aujourd’hui disparue. Le château est mis en vente à la suite du décès de Raymond, survenu en 1964.
Le blason et la devise

Au-dessus du pavillon central, sont entremêlées les lettres L et B sur la gauche pour Le Breton, et L et V sur la droite pour Le Verdier, le nom de sa femme. Une tête de bélier surmonte la sculpture. Représentation de Chrysomallos, le bélier à la toison d’or de la mythologie grecque, souligne le retour à l’antique voulu depuis la Renaissance.

Au-dessus de la porte se trouve la devise du château : « Omnia pro arte » qui veut dire en latin « tout pour l'art. La devise est entourée de feuilles d’acanthe. Ce type d’ornement est très prisé par l’architecture gréco-romaine antique. Gaston Le Breton a ainsi voulu inscrire son engagement pour l’art et pour les artistes qu’il reçoit régulièrement.

L'architecture

L’architecture du château « Le Breton » est de style Louis XIII (période allant de 1610 à 1660).
Il est caractérisé par l’association de la pierre blanche, la brique rouge et le toit d’ardoise. La simplicité des lignes, les références à l’antique et la symétrie sont de rigueur. Les hautes toitures aux charpentes complexes sont surmontées de cheminées et décorées d’ornements de plombs. Ces éléments racontent parfois une histoire, une scène de chasse par exemple.
Le plan est hérité des plans médiévaux qui comprenaient un donjon au centre de 4 tours. Le pavillon central rappelle donc le donjon et les pavillons situés aux angles sont les descendants des tours.
Les pavillons rythment l’architecture dans un jeu d’ombres et de lumière.
Les fenêtres formant les lucarnes au 2e étage sont également typiques du style Louis XIII avec leurs frontons cintrés, c’est à-dire formés en arc de cercle. Lors de la réhabilitation, les fenêtres perdent leurs petits carreaux pour devenir rouges, une couleur vive très appréciée dans le style Louis XIII.
L'influence normande

La façade arrière du château s’éloigne des codes du style Louis XIII pour intégrer ceux de l’architecture normande. La pierre laisse place à la brique et au silex.
Depuis le Moyen Âge, le silex est souvent utilisé pour servir de socle aux poteaux de bois. C’est un matériau économique, résistant à l’eau et qui remplace la bonne pierre lorsqu’elle manque. À partir du XVIe siècle, le silex prend de la valeur et sert de pierre de parement. La mode est de constituer des damiers en jouant sur les différentes couleurs de silex (Manoir d’Ango près de Dieppe).
Avec cette façade, Gaston Le Breton a peut-être souhaité rendre hommage à l’architecture locale du XVIIe siècle, date de construction du 1er château.

L'architecte Lucien Lefort

Lucien Lefort (1850 – 1916) occupe la fonction d’architecte du département entre 1881 et 1914.
À ce titre, il s’illustre dans une série de travaux de construction ou de restauration parmi lesquels figurent : l’agrandissement du palais de Justice de Rouen, la construction de l’école normale de garçons de Rouen, du palais de justice et de la chambre de commerce de Dieppe et l’agrandissement du palais des consuls de Rouen.
Il intervient également sur le château de Robert le Diable, construit l’École Normale d’Institutrices de Rouen, le bâtiment des archives de la Seine-Inférieure, les châteaux d’eau marégraphes de Rouen.
Il travaille sur plusieurs églises à Aumale, Saint-Saëns, Neufchâtel-en-Bray, Montivilliers, Bourg-Dun, Graville, Norville, Saint-Maurice d’Ételan, Villequier et Darnétal. Il construit la sacristie de l’église Saint-Maclou ainsi que le presbytère, le porche de l’église Saint-Vivien, l’église du Sacré-Coeur de Rouen.
Il reçoit plusieurs distinctions, notamment en 1889 : double médaillé d’or à l’Exposition universelle et chevalier de la Légion d’honneur.
Le ferronnier d'art Ferdinand Marrou
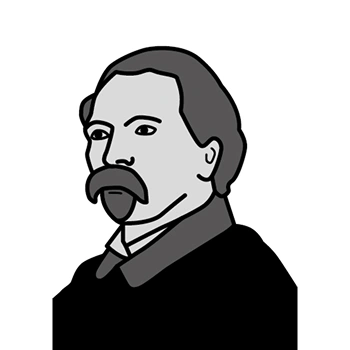
Ferdinand Marrou est né en 1836 dans le Vaucluse et mort en 1917, à Rouen. Ferronnier d’art autodidacte, il a réalisé la majeure partie de son œuvre en Normandie de 1870 à 1914.
De grandes commandes lui sont faites à Rouen. Citons notamment la réalisation des clochetons de la cathédrale de Rouen ou de la décoration du Palais Bénédictine de Fécamp. On admire également sa maison rue Verte et son agence rue Saint-Romain. Reconnu pour ses talents, il participe activement à la vie culturelle rouennaise, dans les mêmes cercles que Gaston Le Breton ou Lucien Lefort (Amis des Monuments Rouennais, Société Libre d’Émulation…). Il obtient de nombreuses récompenses, notamment des médailles aux différentes expositions universelles.
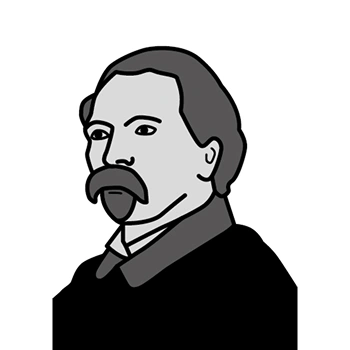
Sur la toiture d’ardoise du château « Le Breton » s’élèvent fièrement 14 épis de faitages monumentaux. C’est l’un des plus beaux ensembles réalisés par Ferdinand Marrou. Il faut ajouter à cela le 15e épi de la chapelle, située dans le parc, qui représente un lansquenet. Ces mercenaires allemands à la réputation houleuse servaient la France au XVe et XVII e siècle. Ils y ont introduit le jeu de cartes qui porte leur nom. Ferdinand Marrou est également à l’origine de la grille et du grand portail situé à l’avant du parc.
Un peu d'histoire...
ZOOM sur le château à travers les époques
-
1620
Le 1er château dit « du Val ». L’abbaye de Jumièges vend le fief de Varengeville à Charles Duval, écuyer et seigneur de Coupeauville.
-
1816
Propriété de Casimir Perier, député de Paris, père du créateur de la banque de France et grand-père du futur président de la République Jean Casimir-Perier.
-
1828
Propriété de Godefroy Rouff, pionnier de l'industrie textile dans la région rouennaise et maire de Saint-Pierre-de-Varengeville 1837 à 1847.
-
1887
Propriété de Édouard Le Verdier, riche négociant et propriétaire de nombreux domaines en Pays-de-Caux. Il fait don du château à sa fille Claire-Marguerite Le Verdier, jeune épouse de Gaston Le Breton.
-
1888 – 1891
Destruction du château du Val pour laisser place au château dit « Le Breton » jusqu’en 1898.
-
Seconde Guerre mondiale
Le château est réquisitionné.
-
1966
Propriété des Frères Garraud qui installe un centre de dressage de fauves dans le parc. Drame tragique en 1967, une employée nommée Madeleine Merle, alors âgée de 21 ans, se fait dévorer par un tigre.
-
1969
Le domaine devient la propriété de la Matmut, sous la présidence de Daniel Havis.
-
2009
Vaste projet de réhabilitation mené par l’architecte Jean-Marc Fabri en vue de créer un lieu d’exposition.
-
2011
Inauguration du Centre d’art contemporain de la Matmut.
-
2020
Lieu rebaptisé en Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis, en l’honneur de son fondateur Daniel Havis.